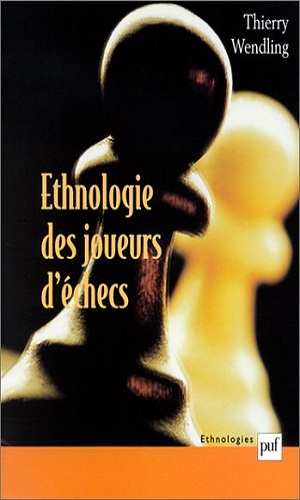 par Thierry Wendling
par Thierry Wendling
Cet ouvrage montre avec force l’intérêt théorique que constitue une approche anthropologique des jeux, en plaçant la notion de culture ludique au centre de l’analyse. Le monde des joueurs d’échecs de compétition, au même titre que toute pratique ludique quelque peu développée, est un petit laboratoire culturel où s’élaborent des systèmes de représentations spécifiques vis-à-vis de la société globale à laquelle les individus appartiennent. La culture échiquéenne présente des réponses originales à des questions (la nomination, le classement, la socialisation, l’usage de la parole, la conceptualisation du temps, la maîtrise du rite…) que toutes les civilisations se posent. Il s’agit donc de comprendre comment les acteurs construisent la signification du monde échiqué en portant une attention soutenue sur les pratiques et discours propres aux joueurs, ce qui tire profit de l’idée d’une cohérence interne forte à cette microsociété dont l’histoire recouvre plusieurs siècles.
Pour mener à bien cette recherche, Thierry Wendling fait le choix, qui se révèle fort judicieux, de la « participation observante ». Joueur d’échecs classé international et membre du comité directeur de la Fédération française des échecs pour les besoins de son étude, l’auteur souligne les limites des règles habituelles qui régissent le rapport de l’ethnologue au terrain pour cerner les moments clés de la culture échiquéenne. Si la présence observante « neutre » ou l’observation participante permettent d’effectuer un compte rendu de la vie d’un tournoi, l’implication dans les parties permet au chercheur de retranscrire avec beaucoup de clarté et de précision comment, dans le silence des salles de compétition officielle, un simple crissement de chaise, un regard un peu trop prolongé ou un raclement de gorge sont des « bruits » lourds de sens traduisant une tension psychologique et dramatique paroxystique. Dans ce cadre, les joueurs sont à la fois acteurs et spectateurs, quittant régulièrement leur table de tournoi lorsqu’ils n’ont pas le « trait » pour observer les autres compétiteurs ou échanger quelques anecdotes « auditivement faibles mais socialement intenses » qui concourent à produire une forte interconnaissance des membres. « Or un bon moyen pour apprendre ce qui se fait et se dit dans les silences feutrés des tournois, ou les huis clos des comités directeurs, c’est d’être joueur et dirigeant soi-même » (p. 23). La mise en exergue de nombre de ces historiettes montre comment celles-ci participent à la construction d’une culture commune. Mais cette culture ludique n’est pas qu’orale. Comme le souligne l’auteur, l’usage de l’écriture pour la conservation des parties distingue véritablement le joueur occasionnel de l’amateur éclairé qui fait partie intégrante du monde des échec. L’avènement d’un système de notation au cours des derniers siècles afin de garder une trace des parties passées a permis aux joueurs de ne plus uniquement considérer leur pratique comme un jeu mais comme une science – avec ses théories sur les ouvertures et les « finales » qui sont sans cesse éprouvées dans les laboratoires que constituent les tournois – et comme un art. « Affirmant que leur jeu connaît une accumulation de savoir et ouvre au plaisir esthétique de répéter des parties brillantes, les joueurs prennent le contre-pied des philosophes qui limitent singulièrement la portée du Jeu en le qualifiant abusivement d’“improductif” » (p. 217). À ce titre, l’analyse de l’émergence et de la structuration des modalités d’inscription des coups offre une valeur épistémologique certaine dès lors que l’on considère les échecs comme objet de science, apportant un véritable jalon pour un projet de sociologie des sciences. Comme le démontre Thierry Wendling, mettre en place un système de notation d’une partie d’échecs nécessite de penser l’espace (l’échiquier), le temps (qui a une structure double dans les échecs, le temps des coups joués et le temps du pendule) et la matière (il faut caractériser la nature des pièces). Plusieurs systèmes se sont longtemps concurrencés, reflétant chacun une façon particulière de conceptualiser ces trois dimensions, avant que la fédération internationale n’introduise une normalisation en 1977 (la notation algébrique actuelle). Mais la constitution de cette « langue échiquéenne universelle » ne doit cependant pas faire oublier « qu’il n’y a au départ ni notation, ni parole, mais mouvement » (p. 214). Dans ce cadre, Ethnologie des joueurs d’échecs révèle de façon fort pertinente que l’intérêt du jeu ne peut être cerné que si l’on dépasse le strict cadre des règles pour prendre en compte le dynamisme des interactions sociales mises en œuvre, la structure logiquo-mathématique d’un système ne déterminant pas pour autant les représentations des acteurs.
Montrer à travers une étude de terrain approfondie que les cultures ludiques relèvent d’une création de sens permanente constitue un éclairage essentiel pour pouvoir comprendre la fortune des phénomènes ludiques actuels, à l’heure où il pourrait apparaître, pour qui se contenterait d’une analyse de « surface », que le jeu dans nos sociétés n’est que le reflet d’idéologies dominantes, dont l’un des avatars médiatiques actuels serait notamment les jeux vidéo. Comme l’atteste cet ouvrage, pour que le jeu puisse véritablement être pris en compte en tant qu’objet de recherche, il est nécessaire de s’écarter de la « théorie du reflet », qui a prévalu dans de nombreux travaux sur ce thème, pour complexifier l’approche. Et à ce propos le travail de Thierry Wendling manifeste que les amateurs de jeu d’échecs contredisent une approche sociologique classique « qui voudrait que l’on choisisse son loisir en fonction de sa profession ou de sa catégorie socioprofessionnelle » (p. 241), en montrant que d’autres valeurs que celles issues d’une activité « productive » sont mobilisées. L’analyse du rôle de ces valeurs dans la médiation ludique est alors essentielle pour quiconque souhaite mener une sociologie à partir des jeux, pour reprendre l’expression consacrée de Roger Caillois.
Édition Presses universitaires de France, coll. Ethnologies 2002 / Ref : HIS-WEN
Présentation : Broché – 22,5 x 13,8 cm – 256 pages
Mots-clés : histoire, littérature, psychologie
